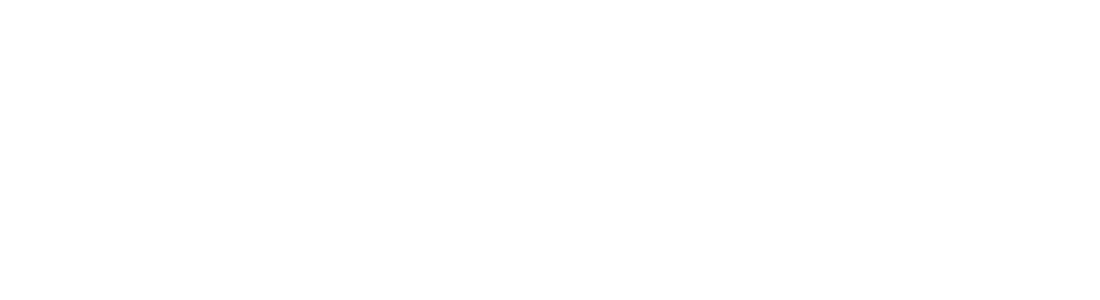Justice et Temps : Entre contraintes procédurales et enjeux de société
« Juger, c’est prendre le temps de trouver la juste distance entre une situation, des faits et des émotions »
(Claire Marie CASANOVA, magistrat – ancien conseillère du Garde des Sceaux)
***
Dans la suite de ma participation au TedX de LA BAULE où j’ai été amené à réfléchir sur le Temps Judiciaire, il m’a semblé intéressant de livrer ici le fruit de ma réflexion (vidéo ici).
***
Le rapport entre la Justice et le Temps constitue une problématique centrale du droit contemporain, particulièrement en matière pénale. Le temps y est à la fois un cadre technique, une réalité matérielle, et un facteur d’influence sur la perception et la qualité de la décision judiciaire.
Le temps comme norme procédurale
La Justice pénale est d’abord encadrée par des temporalités définies par la loi : délais de prescription, durée des peines, périodes de sûreté. La prescription fixe la durée pendant laquelle une infraction peut être poursuivie ; elle matérialise une limite temporelle au droit de punir. La peine, quant à elle, est souvent exprimée en années d’incarcération, reflétant une conception chronologique du châtiment.
La période de sûreté, imposée dans certains cas, vient renforcer cette logique : il s’agit d’un temps incompressible pendant lequel la personne condamnée ne peut bénéficier d’aucun aménagement de peine.
Le temps comme réalité judiciaire
Au-delà des normes, le temps est également une composante concrète de la procédure judiciaire. Les retards dans le traitement des dossiers, la lenteur des enquêtes, des instructions, ou encore les délais pour obtenir des décisions participent à l’expérience du justiciable et interrogent l’efficacité du service public de la Justice.
Ce décalage entre l’attente sociale et les délais procéduraux alimente une critique récurrente : la lenteur judiciaire serait le symptôme d’un système à bout de souffle, faute de moyens suffisants. Toutefois, lorsque la justice devient trop rapide — à l’image des comparutions immédiates — elle est tout autant contestée, cette fois pour son manque de profondeur et de discernement.
L’enjeu des délais dans les affaires criminelles
Un problème majeur se pose lorsque le temps entre les faits et le procès s’étire sur plusieurs années. Durant cette période, les parties poursuivent leur vie, reconstruisent parfois un équilibre, ce qui complexifie l’appréciation des faits à l’audience.
Un procès pénal qui intervient plusieurs années après les faits peut apparaître comme un retour brutal en arrière. Cela soulève la question de la pertinence du procès au regard du droit à l’oubli, de la réinsertion ou de la stabilité retrouvée par les parties. Par ailleurs, le caractère apaisé ou conflictuel de l’audience peut être profondément influencé par le temps écoulé.
La prescription : équilibre entre mémoire et oubli
La prescription incarne une tentative de conciliation entre l’impératif de justice et les exigences de sécurité juridique. Elle repose sur l’idée qu’au-delà d’un certain délai, il n’est plus raisonnable ni équitable de juger un individu, du fait de la dégradation des preuves et de la difficulté à établir la vérité.
Certains crimes — comme les crimes contre l’humanité — sont imprescriptibles. Pour d’autres, notamment les infractions sexuelles contre les mineurs, les délais peuvent s’étendre jusqu’à 30 ans après la majorité de la victime.
Le débat autour de l’allongement, voire de la suppression de la prescription, suscite des réserves de la part des professionnels du droit. L’enjeu n’est pas tant de nier la gravité des faits que de garantir un procès équitable, fondé sur des éléments de preuve suffisamment solides. La mémoire n’est pas toujours fiable, et tout oubli n’est pas nécessairement nuisible. L’idée d’une « indispensable prescription », même dans des cas moralement sensibles, est défendue comme un rempart contre l’arbitraire.
Le temps comme facteur de pédagogie judiciaire
Le temps peut aussi être un allié : il permet parfois une maturation des postures, une meilleure compréhension des enjeux, voire un cheminement vers la reconnaissance des faits. Juger trop vite peut empêcher cette évolution et conduire à des décisions hâtives, moins justes.
Mais ce bénéfice est fragile et aléatoire. L’excès de délai peut également engendrer des drames personnels, notamment lorsque la procédure rouvre des plaies profondes ou crée des attentes irréalisables. C’est pourquoi le temps judiciaire, loin d’être une simple variable neutre, est un élément structurant du procès, qui mérite d’être pensé et encadré.
Conclusion
Le temps, en matière judiciaire, n’est ni neutre ni toujours bienveillant. Il peut être garant de sérénité ou source d’injustice. Toute réforme visant à modifier les délais de prescription ou à accélérer le traitement des affaires doit donc intégrer cette double réalité : la justice ne peut être efficace que si elle reste équilibrée, et elle ne peut être juste que si elle demeure humaine.